Pour mieux comprendre la crise grecque actuelle, quelques éléments sur l’histoire de la Grèce moderne.
TÉLÉCHARGEZ L’ARTICLE EN PDF: Pour mieux comprendre la crise grecque actuelle
La Grèce moderne est née d’une guerre d’indépendance qui dura de 1821 à 1827. Elle sort ainsi de près de 400 ans d’occupation ottomane.
Kapodistrias diplomate originaire de Corfou est le premier gouverneur de la Grèce moderne. Le territoire du pays est bien inférieur à celui d’aujourd’hui et l’Etat est ruiné par la guerre d’indépendance. Les puissances qui, contraintes par leur opinion, ont apporté leur aide au mouvement d’indépendance (France, Royaume-Uni et Russie) n’acceptent pas  l’éventualité de voir naître en Méditerranée orientale un nouvel état maritime indépendant. La vie politique et économique du pays passe ainsi très vite sous le contrôle de ces États européens qui s’autoproclament « Puissances protectrices ». Les divisions des Grecs leur permettent dès 1832 d’imposer une monarchie absolue en la personne d’Othon second fils du roi de Bavière.
l’éventualité de voir naître en Méditerranée orientale un nouvel état maritime indépendant. La vie politique et économique du pays passe ainsi très vite sous le contrôle de ces États européens qui s’autoproclament « Puissances protectrices ». Les divisions des Grecs leur permettent dès 1832 d’imposer une monarchie absolue en la personne d’Othon second fils du roi de Bavière.
1834 : Athènes devient capitale de la Grèce
La Grèce s’engage dans divers conflits soutenue par les « Puissances Protectrices » qui même si leurs intérêts divergent souhaitent contrôler ce secteur stratégique de la méditerranée. Le mécontentement populaire s’amplifia au cours du règne d’Othon 1er : il fut renversé par un coup d’état et dû abdiquer en 1862.
Le règne de Georges Ier, deuxième roi de Grèce est marqué par la volonté de mettre en œuvre la « Grande idée » (Μεγαλη ιδέα): réunir toutes les populations grecques dans l’État grec, le but est la reconquête de la capitale historique et de l’orthodoxie : Constantinople.
Grâce à l’habileté du premier ministre Elefterios Vénizelos qui accède au pouvoir en 1909, la Grèce obtient la Crète, les îles Est de la mer Egée et de larges territoires au Nord : le territoire grec se rapproche de celui que nous connaissons aujourd’hui.
Malgré tout, la politique de Georges et de ses gouvernements est loin d’être toujours couronnée de succès et des humiliations nationales (blocus contre le pays en 1885 par les « Puissances protectrices », défaite lors de la guerre gréco-turque de 1897) ponctuent son règne.
Durant la première guerre mondiale il y eut conflit entre le roi Constantin pro-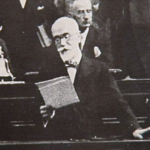 allemand et le premier ministre Eleftérios Vénizelos pro-alliés. Celui-ci créé un gouvernement provisoire à Salonique et peu après la Grèce rejoint effectivement le camp des alliés.
allemand et le premier ministre Eleftérios Vénizelos pro-alliés. Celui-ci créé un gouvernement provisoire à Salonique et peu après la Grèce rejoint effectivement le camp des alliés.
En 1922, le corps expéditionnaire grec chargé de faire appliquer le traité de Sèvres est anéanti par l’armée turque. Le traité de Lausanne qui suivi décida de procéder à un échange de populations. Ainsi 1 200 000 « grecs » (tous les orthodoxes furent assimilé grecs!) quittèrent la Turquie et 500 000 turques (tous les musulmans furent assimilés turques » quittèrent la Grèce. Cette migration forcée fut à l’origine d’une énorme explosion urbaine et de l’émergence de véritables bidonvilles. Ces événements désignés sous le terme éloquent de « la Catastrophe » par les grecs ont assombri toute la période de l’entre deux guerres.
La Grèce est alors extrêmement divisée entre partisans de Venizélos (républicains) et monarchistes. Les premiers ministres monarchistes, boucs émissaires du désastre sont fusillés. Dans une grande instabilité politique se succèdent coups d’états, proclamation de la république (1924) et dictatures.
Le pays doit faire face à la question des réfugiés d’Asie mineure, la nécessité d’une réforme agraire, le développement industriel et le besoin de législation sociale. En dépit des divisions, les années 20 et 30, voient la mise en place d’une politique de développement équilibré du territoire qui ne trouve pas d’équivalent dans la Grèce de l’après seconde guerre mondiale. Cette tentative est brisée financièrement et économiquement par la crise de 1929.
De 1936 à 1941 la dictature du général Métaxas mis en œuvre une persécution systématique des communistes et de leurs sympathisants et le démantèlement du KKE (parti communiste grec).
Le 28 octobre 1940, l’armée italienne de Mussolini attaque le territoire de la Grèce à la frontière albanaise. La contre attaque grecque est couronnée de succès. En avril 1941, Hitler est alors contraint d’envoyer son armée conquérir la Grèce. Le retard d’un mois qui s’en suivi empêchera l’armée allemande de remplir ses objectifs en URSS avant l’hiver 41-42, avec toutes les conséquences ultérieures.
Le pays est divisé entre 3 occupants, Allemagne, Italie et Bulgarie, sans coordination, chacun pillant pour son compte. Une famine unique en Europe occupée sévit durant l’hiver 1941 qui causa la mort de plus de 300000 personnes et obligera l’occupant à accepter un ravitaillement humanitaire sous pavillon neutre.
De 1941 à 1943 la résistance se développe et s’organise autour de plusieurs organisations parfois rivales. La principale sera le front de libération national (EAM) et son prolongement militaire (ELAS). La résistance s’apparente à une véritable guérilla favorisée par le relief très montagneux du pays. Elle est soutenue par une part importante de la population subissant la violence de l’occupant et acculée à la misère (1 grec sur 7 serait membre de l’EAM en 1943!).
Entre 1943 et 1945 l’occupant nazi fait régner une terreur d’une violence inouïe. Le bilan chiffré des morts sous l’occupation bien qu’incertain donne une idée de cette démesure : 500 000 morts soit 8% de la population dont 340 000 morts de faim et 70 000 des représailles allemandes, 1000 villages détruits.
L’EAM met également en place dans des régions sous son influence un système gouvernemental inédit (laocratie) créant notamment des comités de villages pour
la gestion des affaires locales et régionales. Cependant tous ceux qui n’adhéraient pas à cet élan politique étaient vite considérés comme malveillants et ennemis. Nombres d’exactions violentes eurent alors lieu contre eux.
La Grèce sort de la guerre avec un État et une économie décimés.
En 1944, l’accord de YALTA négocié entre Roosevelt, Churchill et Staline place la Grèce dans le camp occidental.
Tout est en place pour la première phase de la guerre civile qui se déroule à Athènes entre d’une part l’ensemble de la droite (royalistes et républicains confondus) et les collaborationnistes, tous soutenus par les britanniques et d’autre part les résistants communistes et leurs sympathisants.
Après des élections et un plébiscite sur la monarchie organisé en 1946 de manière peu démocratique, la gauche reprend le maquis. L’aide massive des anglais puis des américains parvient à écraser cette résistance, foyer par foyer, jusqu’en 1949. Le bilan de cette guerre civile s’élève à 158000 morts et laisse une fois de plus la Grèce ruinée socialement et économiquement.
De 1947 à 1974, les États-Unis ont joué un rôle prépondérant dans la vie politique grecque. Leur principal moyen de pression était leur aide militaire et économique, il suffisait d’évoquer sa diminution pour gommer toute résistance du gouvernement grec. Ils soutiennent Constantin Caramanlis nommé premier ministre en 1955 qui constitue un exécutif fort. Le niveau de vie de la population grecque augmente notablement. Cependant les insuffisances toujours réelles de l’État grec, laisse fleurir le clientélisme qui fait du député l’homme providentiel de sa circonscription.
L’arrivée au pouvoir par les élections de 1963 du centriste Georges Papandréou change la donne. Son gouvernement d’Union du Centre fit d’importantes réformes, principalement en matière d’éducation, mais il se heurta cependant au roi Constantin II dans sa volonté de réformer l’armée (très marquée à l’extrême droite), les affaires chypriotes fragilisèrent également le gouvernement.
Des actions politiques et leur corolaire répressif s’intensifient devant le refus du roi de confier le pouvoir à la gauche. L’assassinat du député Lambrakis qui a inspiré à Costas Gavras le film « Z » est révélateur de cette période.
Ces troubles politiques aboutirent au coup d’État des colonels le 21 avril 1967 soutenus par la CIA. En 1973, le régime organisa un plébiscite qui aboutit à l’abolition de la monarchie et à la proclamation de la République. La crise chypriote fut fatale au régime des colonels, déjà affaibli par une forte protestation. Le paroxysme de cette protestation est atteint en 1973, lorsque des étudiants, suivis de la classe ouvrière occupe l’École Polytechnique d’Athènes (Polutecneio), qui fut évacuée par les chars le 17 Novembre.
atteint en 1973, lorsque des étudiants, suivis de la classe ouvrière occupe l’École Polytechnique d’Athènes (Polutecneio), qui fut évacuée par les chars le 17 Novembre.
En 1975, C. Caramanlis réfugié en France, revient au pouvoir et instaure une constitution proche de celle de son pays d’exil, Caramanlis étant un grand admirateur du Général de Gaulle. La vie politique se bipolarise comme ailleurs en Europe autour de « la Nouvelle démocratie » et du PASOK « parti socialiste panhellénique » qui gagnera les élections en 1981 amenant pour la première fois la gauche au pouvoir en Grèce.
Général de Gaulle. La vie politique se bipolarise comme ailleurs en Europe autour de « la Nouvelle démocratie » et du PASOK « parti socialiste panhellénique » qui gagnera les élections en 1981 amenant pour la première fois la gauche au pouvoir en Grèce.
Les deux chefs charismatiques C. Caramanlis et A. Papandréou annoncent tous deux une vie politique modernisée, s’éloignant du paternalisme et du clientélisme traditionnel, mais se comportent en patriarches intransigeant au sein de leur parti respectif. On compte de nombreux scandales financiers dans la classe politique grecque.
La Grèce pays historiquement d’émigration devient à partir de 1977 un pays d’immigration.
La Grèce adhère à la communauté européenne en 1981. Dans ce contexte l’agriculture est orientée vers des productions fortes de blé dur, huile d’olive, coton et viande ovine, le réseau industriel de l’ouest de la Grèce est mis à mal et l’économie de service (notamment le tourisme) est très fortement développée. Les dépenses pour le développement des régions les plus pauvres, les grandes infrastructures de transports (autoroutes, ponts, métro, aéroports) sont privilégiées.
Après une période où l’adhésion à la CEE, apporte une manne financière pour le pays, les réformes commencent à partir de 1996, pour « européaniser » l’économie grecque.
réformes commencent à partir de 1996, pour « européaniser » l’économie grecque.
Il s’agit de passer d’un État interventionniste et protectionniste, au libéralisme financier et à l’ouverture sur les marchés. Peu à peu les monopoles publics sont remplacés par des monopoles internationaux et financiers. En 1997, chacun sait que la Grèce est encore loin des critères définis à Maastricht.
En 2001, pourtant la Grèce entre dans la zone euro.
En 2004, les jeux olympiques d’Athènes coûtent une fortune à la Grèce, entre 14 et 20 milliards d’euros selon les estimations ! La même année le gouvernement grec admet avoir falsifié ses comptes pour donner l’illusion qu’il respectait les critères de Maastricht.
En 2009 : G. Papandréou (fils de A. Papandréou) arrivé au pouvoir (PASOK), augmente de + 12,7% le déficit. Les agences de notations dégradent la note de crédit à long terme d’Athènes. Les taux d’intérêt d’emprunts grecs s’envolent.
Depuis se succède plans d’austérités, grèves générales, tensions politiques (entrée du parti d’extrême droite « Aube dorée » à l’assemblée nationale en 2012).
La situation politique, économique et sociale est catastrophique ainsi,
- Le salaire moyen en Grèce a baissé de 45% entre 2010 et 2012.
- Le taux de chômage atteint 26,8% en janvier 2013, il était de 9,2% encore en 2009
- Après trois plans d’austérité qui imposent la disette à la majorité des grecs la dette du pays a …augmenté : 144.5M€ en 2010, 165.4M€ en 2011 et la prévision pour 2013 serait 181.8Milliards€ !
- Concernant la liberté de la Presse, la Grèce passe du 70ème (2012) rang au 84ème en 2013
- La Grèce autrefois le pays européen présentant le plus faible taux de suicide présente en 2012 un des plus élevés
- Le dernier rapport de l’ONU pointe du doigt les conditions de détentions dans le pays
- Le conseil de l’Europe précise récemment que « les attaques racistes sont une menace réelle pour la démocratie » en Grèce.
- ……
TÉLÉCHARGEZ L’ARTICLE EN PDF: Pour mieux comprendre la crise grecque actuelle
Pour en savoir plus :
- http://www.okeanews.fr
- La Grèce depuis 1940, J. DALEGRE, éd. L’Harmattan, 2008.
- Dans la Grèce d’Hitler, M.MAZOWER,Coll. Tempus, éd. Perrin, 2012.
- Géopolitique de la Grèce, G. PREVELAKIS, éd. Complexe, 2006.
- Le monde diplomatique, février 2013.
Collectif Solidarité Normandie Grèce
Contact : caensolgrece@gmail.com Tél : 06 16 44 74 67
Pour en savoir plus :
- La Grèce depuis 1940, J. DALEGRE, éd. L’Harmattan, 2008.
- Dans la Grèce d’Hitler, M.MAZOWER,Coll. Tempus, éd. Perrin, 2012.
- Géopolitique de la Grèce, G. PREVELAKIS, éd. Complexe, 2006.
- Le monde diplomatique, février 2013.
- Site Web OKEANEWS












